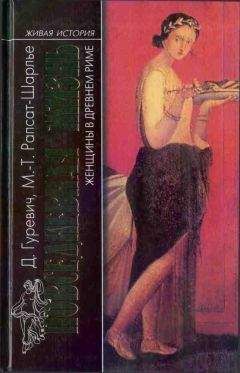Юрий Малинин - Франция в эпоху позднего средневековья. Материалы научного наследия
Dans ce cas il s'agit sans aucun doute de 1446. Selon G. Bianciotto, la composition alla d'août 1446 à février 1447, puisqu'en février le roi René partit pour la Provence, où notre auteur figurait vraisemblablement dans sa suite.{640} Aussi se hâta-t-il de terminer son travail, dont il dit:
Pardonnez moy si je m'avance;
Pour le voyage de Prouvence
Je fais ung peu de proveancs
Et m'en suis plustoust délivré.
Aiez ung peu de pascience,
Suppliez a mon inscience
D'user de si sote science:
Tantoust auray le dit livré. (sir. 209)
Pourtant, selon moi, on peut lui faire tout à fait confiance quand il dit que «ce dit fait ce darrain esté». Il est vraiment difficile d'admettre qu'il a terminé son travail au bout de douze mois, c'est-à-dire à la fin août. Mais il faut se rappeler qu'au Moyen Âge, on appelait été toute la saison chaude de l'année, que l'on divisait ainsi simplement en été et hiver. Aussi l'été comprenait une bonne partie de l'automne, et dans ce cas notre auteur pouvait parfaitement terminer son travail pendant «l'été».
Quel est l'univers intellectuel et moral de notre auteur et quelle culture avaitil reçu dans l'ermitage dont il parle? Ce qui saute aux yeux, ce sont ses connaissances historiques, car il évoque souvent des personnages historiques ou mythologiques, qui font partie presque exclusivement des héros du passé et forment une sorte de panthéon de la chevalerie. Il ne distingue naturellement pas les figures de la réalité des figures légendaires. Ils sont tous pour lui de vaillants chevaliers auxquelles il compare les participants de la joute de Saumur. Ce sont le roi Artur, et Charlemagne, et Perceval, et Roland, et Jules César, et Hannibal.
Mais ses connaisances historiques sont très confuses.
Alexandre qui conquis plus,
Aussi Julius Gayus,
Ces trois juits et deux païens.
(str. 236)
A qui pense-t-il pour Gaius et Julius et qui est le troisième Juif? On pourrait supposer que Gaius et Julius ne sont autres que Caius Julius César, mais il le nomme un peu plus loin:
Julius César et les siens,
Pompée, Cartaige et Priens
Qui tant conquisdrent de biens… (str. 236)
Derrière toute cette confusion, il y a une culture historique tout à fait caractéristique de cette époque, une culture romanesque, c'est-àdire tirée des romans de chevalerie. Il a certes lu quelque chose à côté. C'est ainsi qu'il cite Végèce, quelques «histoires de Grèce, d'Albion, de Troie et de Lutèce», sans qu'on sache clairement à quoi il pense en parlant de ces «histoires».
Il ne cite précisément qu'une oeuvre historique: «les histoires de Beauvoir». C'est sans doute «le Miroir historique» de Vincent de Beauvais (str. 138). On peut attribuer la faute d'orthographe (r au lieu de s) à un copiste. Il renvoie à cette œuvre en expliquant l'origine du comté de Clermont, qui avait été au départ institué pour un des fils du roi Louis IX le Saint, mais notre auteur laisse là passer deux fautes dont on peut difficilement rendre responsable le copiste. Il appelle le fils du roi, Haubert, alors qu'il s'appelait Robert et il écrit qu'il était le second fils du roi, alors qu'en réalité il en était le sixième.
Notre auteur était profondément pénétré des idées de son temps, bien que, vu le caractère et le genre de son œuvre, elles ne soient pas exposées dans un système logiquement développé. Pourtant on peut percevoir ses idées socio-politiques au travers de pensées, remarques et épithétes isolées.
Ainsi reproduit-il exactement le schéma de l'organisation sociale en trois classes, caractéristique du Moyen Âge: guerriers, orants et laborants. De plus, citant ces trois niveaux sociaux, il met à la première place les guerriers, la noblesse:
Es nobles la lance et la lame
A l'orateur chante de game,
Au laboureur, clerc ou bigame,
Son labeur en loyal endroit. (str. 233)
Une telle logique selon laquelle la noblesse est plus haute que les autres classes et surtout que le clergé, puisqu'elle défend le peuple entier les armes à la main, était à cette époque propre aux œuvres des laïcs, des chevaliers, tandis que le clergé défendait la priorité de sa classe. Mais notre auteur, on peut le supposer, était plus attaché aux œuvres des écrivains de chevalerie.
Son interprétation des bases de l'organisation sociale est excessivement naturaliste: elles sont prédéterminées par la nature et la raison en tant que principaux biens naturels de l'homme. Il écrit à ce propos:
Raison, qui est sus tout la dame
Et doit dominer homme et femme,
Donneroit a tout estât blasme
Si chascun ne usoit de son droit
Qui autrement faire vouldroit,
A nature son train tousdroit
Et condicion deffauldroit,
Règle et loy perdroint leur saison. (str. 233)
Recourant à cette allégorie de la raison, habituellement représentée sous les traits d'une noble dame, il généralise par là-même l'idée de raison, en y voyant l'intendant universel, qui gère le droit naturel ou la loi de nature. Cette loi est pour partie le droit de chaque condition sociale et de chaque homme, selon lequel chacun doit vivre et s'occuper de la tâche qui lui est fixée.
Ses idées politiques sont également traditionnelles, surtout sa conception des obligations du souverain. Ainsi écrit-il à propos du roi René:
Qui tant a mis tout son pouvoir,
Son entendement et savoir
Et largement de son avoir
Au bien de la chouse publique. (str. 228)
Le souverain idéal est celui qui soutient le bien de la société en assurant la justice et en maintenant l'ordre naturel et raisonnable.
Cependant, les idées socio-politiques et les réminiscences historiques ne sont que des éléments disséminés dans un texte poétique, inspiré par l'idéal courtois et chevaleresque. Son auteur est typiquement le clerc français qui renonce sans problème aux graves pensées sur la mort et sur Dieu pour les vivantes formes qui le ravissent de la culture courtoise et chevaleresque. Une seule fois il se livre à une réflexion sur la mort (str. 20), après quoi dit-il:
Retournons a ceulx du ehastel
Et prenons langaige nouvel.
Laissons celluy qui n'est pas bel
Ny bien consonant a nature
Trop plus plaisant est renouvel
D'armes, de lance ou de coustél. (str. 21)
Et qu'estime-t-il le plus? Posant la question: «Ou est plus riche le trésor!» (str. 21), il répond:
Le parsonnaige, la facture,
Le bel maintien et la stature,
Au gré de noble créature,
Cent mille fois trop plus que d'or. (str. 21)
Ce qui nous donne envie de tenter une supposition sur l'âge de notre auteur. Vraisemblablement, il est jeune. Plus mûr, il aurait montré plus de prudence dans ses jugements, surtout étant moine.
Toute son œuvre est pénétrée de l'esprit courtois; et sous ce rapport il traduit fidèlement l'atmosphère des fêtes de Saumur. C'est en cela d'ailleurs que se distinguent tous les tournois et joutes du Moyen Âge. Mais les compétitions organisées par le roi René se signalent par un rituel courtois extrêmement élaboré. La joute de Saumur «entreprins fut pour une dame, au gré d'amours», (str. 2). L'auteur ne cite pas son nom et se contente de remarquer: «sus mon âme on ne saurait plus belle eslire». (str. 2). On a émis la supposition qu'il s'agissait de Jeanne de Laval, que le roi René épousa plus tard, après la mort d'Isabelle de Lorraine. Mais elle n'était pas présente aux fêtes, aussi G. Bianciotto at-il raison de remarquer à propos de cette dame qu'ici «la fiction amoureuse est présente et en aucune façon voilée».{641}
Les participants, écrit l'auteur au début de son poème, étaient:
Tous actains d'amoureuse flamme,
Sans villain penser n'aultre blasme. (str. 2).
Le symbole de la joute était «la nouvelle fleur», que l'on commençait depuis peu de temps à cultiver «l'a pensée». L'écu, qui avait été hissé sur la colonne de marbre, était couvert de ces fleurs, ainsi que les caparaçons des chevaux et les écus des «tenants» commandés par le roi. Ainsi le roi René avait-il renouvelé l'esprit de la compétition. Il marchait avec ses chevaliers en qualité non pas de défenseur du «pas» comme c'était l'habitude dans l'organisation d'un «pas d'armes», mais de défenseur de la fleur qui, on peut le supposer, était un symbole de l'amour.
Bien que notre auteur ne connût, parmi la multitude de dames qui s'étaient rassemblées là, que la seule dame de Beauvau, il parle avec enthousiasme de toutes celles qui se rassemblèrent dans le château où règne «vraie amour», il leur attribue toutes les qualités possibles et pathétiquement s'écrie en conclusion:
…et si j'avoie cent mille âmes
Pour elles les mectroie es flammes
Des après feux d'ardant désir
Pour repprouver tous les infâmes,
Faulx langaigiers, plains de diffames,
Murtriers d'onneurs, venons et famés,
Qui ont a mal parler plaisir. (str. 43)
Pourquoi tant de passion à condamner les calomniateurs des belles dames? La question a son importance, car il ne s'agit pas simplement de rhétorique. La défense de l'honneur des dames était un élément essentiel de la conception de l'amour courtois, dans la mesure où cet amour était pensé presque exclusivement comme hors du mariage. Habituellement le bon renom d'une dame devait être sauvegardé au détriment du secret de l'amour, dont personne, sauf les amants, ne devait avoir connaissance. En outre la responsabilité principale incombait a l'homme, qui se présentait comme le garant du secret amoureux et de l'honneur de sa bien-aimée, et la divulgation qu'il faisait de ce secret était regardée comme un crime contre l'amour. André Le Chapelain, auteur du plus célèbre traité sur l'amour courtois, donne à ce propos cet exemple:
«Un chevalier divulgua honteusement les secrets de son amour et ses intimes affaires de cœur. Tous ceux qui servent dans la chevalerie d'amour demandent que ce délit soit très sévèrement puni, de peur qu'en laissant impuni l'exemple d'une telle trahison, on ne donne aux autres l'occasion de la suivre. Une cour de dames fut donc réunie en Gascogne, et l'on décida à l'unanimité que cet individu serait désormais frustré de toute espérance d'amour, et considéré comme indigne et méprisable aux yeux de tous».{642}
L'univers intellectuel et moral de notre auteur s'était formé sans doute sous l'influence des idées d'amour courtois. Et dans ses conceptions tous les chevaliers qui étaient descendus à Saumur, prirent part à la joute
Pour l'onneur d'armes aquerir,
Et pour oster sans mesprison
Celle amoureuse poison
Dont nul n'a jamés guerison
Sans dame humblement requérir. (str.281)
Comme l'écrivait le roi René dans le livre des tournois pour en expliquer la nécessité et l'utilité, «par aventure pourra-il advenir que tel jeune chevalier ou escuier, par bien y faire, y acquerra mercy, grâce ou augmantation d'amour de très gente dame et cellée maistresse».{643}
Pour tous deux, conformément à l'ancienne tradition, l'amour devait absolument être lié à la sauvegarde du bon renom de la dame et à sa défense contre les calomniateurs. Notre auteur consacre à cet objet une strophe de son oeuvre et, s'en prenant aux «murtri-ers d'onneurs, renons et famés» (str.43), il exalte «loyalle dame Renommée», qui «es armes du pas fut présente tous les jours jusques a quarante» (str. 44). Recourant à cette allégorie, il fait comprendre que les participants à la compétition étaient fidèles aux commandements de l'amour et n'étaient pas capables de calomnier les femmes.
Le roi René se présente à son tour comme un authentique paladin de l'honneur et du «renom» des femmes. Dans son Traité sur les tournois, il prévoit même une cérémonie particulière et un tribunal spécial qui permettront de protéger le bon renom de la dame. La veille de la compétition, tous les participants, selon l'idée du roi, rassembleront leurs heaumes avec les timbres dans une galerie du cloître, après quoi
«viendront toutes dames et damoiselles, et tous seigneurs, chevaliers et escuiers, en les visitant d'ung bout à autre… et y aura ung hérault ou poursuivant, qui dira aux dames selon l'endroit où elles seront le nom de ceulx à qui sont les timbres, ad ce que s'il y en a nul qui ait des dames mesdit, et elles touchent son timbre, qu'il soit le lendemain pour recommandé. Touttefois nul ne doibt estre batu oudit Tournoy, se non par l'advis et ordonnance des juges, et le cas bien desbatu et attaint au vray, estre trouvé tel qu 'il mérite pugnicions et lors en ce cas doibt estre si bien batu le mesdisant, que ses espoules s'en sentent très bien, et par manière que une autreffois ne parle ou mesdie ainsi deshonettement des dames, comme il a acoustumé».{644}