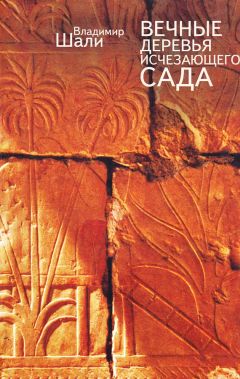Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004
Se mettre en état de penser, demande de ceux qui l’entreprennent qu’ils mettent en œuvre une lucidité, un sang‑froid et une sobriété capables de balayer sans désemparer hors de leur horizon la masse de lieux communs, de figures de rhétorique et d’idées reçues qui forme le fonds de
fonctionnement de la pensée commune.
Si nous avons réellement l’intention de nous confronter à la tentative de penser la technique, il faut donc savoir que cela va nous demander, à nous aussi, de nous arracher aux pesanteurs de la pensée ordinaire. C’est beaucoup plus difficile à accomplir qu’à énoncer, pour la raison que nous avons tous spontanément l’inclination à penser comme pense tout le monde. C’est en chacun de nous que vit, jamais complètement surmontée, la peur par excellence, celle d’avoir à penser par soi‑même. Nous avons peur de penser autrement qu’à l’aide des instruments de l’habitude et du conformisme, parce que penser vraiment est l’une des formes les plus aiguë du risque qu’est nécessairement exister, lorsqu’exister implique qu’il faille en existant endurer sa propre finitude.
Mais pourquoi donc penser la technique? Nous voilà semble‑t — il, devant le dernier obstacle. Car si l’urgence de penser la technique vient d’ailleurs que de la pensée elle‑même — si par exemple elle tire sa motivation des inconvénients dont le développement technique finit par répandre un peu partout la sourde inquiétude, alors il y a fort à craindre que sous la rubrique “pensée de la technique” ne se trouve en réalité rien d’autre que ce dosage de réactions sociales consensuelles qui passe pour être la pensée.
La pensée véritable est rupture — comme est rupture tout ce qui a un vrai poids dans une vie humaine. Rupture par rapport à ce qui précède, mais surtout rupture relativement à tout ce qui usurpe l’apparence d’être proche — bref: rupture qui ne cesse de rompre avec l’imposture.
À propos de la question de la technique, écoutons ce que dit Jean Beaufret. Cet homme a si admirablement appris à pratiquer l’art de rompre en se dépaysant jusqu’à soi‑même, qu’il en est devenu, même en France, comme un étranger. Comment s’expliquer autrement que pour le vingtième anniversaire de sa mort, survenue le 7 août 1982, n’ait paru en France
qu’un seul hommage à Jean Beaufret?
Je tiens à saluer la présence parmi nous, ce matin, de celui qui a écrit cet hommage: Pierre Jacerme. Son texte s’intitule Martin Heidegger et Jean Beaufret/Un dialogue [“Revue philosophique”, 2002, n° 4].
Il y a presque quarante ans, le 9 septembre 1963, Jean Beaufret écrivait à Heidegger (à la veille, donc, du dixième anniversaire de la conférence):
«Je crois que je vois, encore mieux qu’à Meßkirch, l’extraordinaire difficulté de “Die Frage nach der Technik”. Car il s’agit de la question des questions, qui par‑delà Aristote, remonte jusqu’à Héraclite, dans la mesure où le caractère irrésistible de la technique, en son déploiement plénier, répond au secret lui- même, au kruvptesqai de la fuvsi", au fait en retrait que <la fuvsi" se révèle ainsi>, par quoi l’histoire tout entière de l’allégie de l’estre‑même est portée.»
La lettre ne parle pas — il faut le dire — exactement en ces termes. Jean Beaufret, qui écrit jusque là en français (sauf en mentionnant le titre “Die Frage nach der Technik” — peut—être comprenons‑nous à présent pourquoi), à partir de “jusqu’à Héraclite”, passe en effet à l’allemand, ce qui donne comme texte — écoutons‑le tel qu’il fut reçu par Heidegger:
«Je crois que je vois, encore mieux qu’à Meßkirch, l’extraordinaire difficulté de “Die Frage nach der Technik”. Car il s’agit de la question des questions, qui par‑delà Aristote, remonte jusqu’à Héraclite, insofern das Unaufhaltsame des Wesens der Technik dem Geheimnis selbst, dem kruvtesqai der fuvsi", dem verborgenen “Daß” entspricht, durch das die ganze Lichtungsgeschichte des Seyns getragen ist.»
Que se passe‑t — il avec ce changement de langue? Il n’est pas superflu de poser la question, d’autant moins que par là — avant même de nous mettre à traduire de ce qu’écrit Jean Beaufret — nous avons occasion de préciser le sens du questionnement. Il est bon, en effet, lorsque nous questionnons, de nous demander si nous questionnons sur… ou bien si nous questionnons après.?
Pourquoi Jean Beaufret passe‑t — il du français à l’allemand? N’est‑ce pas justement parce qu’il entreprend de questionner dans le sens que nous cherchons à mettre en évidence — c’est—à-dire non pas à propos de quelque chose qui serait là sous nos yeux, mais vers ce qui non seulement n’est pas là, mais ne cesse de se dérober — selon une échappée dont l’emportement seul peut frayer le passage à une approche?
La question de la technique, dit‑il, est “la question des questions”. Entendre cette formulation suivant la pente habituelle de nos compréhensions, fait simplement passer à côté de ce qu’il s’agit de penser. Car la question de la technique n’est pas Ja question auprès de laquelle toutes les autres feraient pâle figure. C’est la question des questions au sens où, en elle, viennent se résumer toutes les autres questions, dans la mesure précise où elles sont bien autre chose que des demandes d’information; c’est la question en laquelle toutes les questions philosophiques trouvent en quelque sorte leur figure emblématique.
Tâchons de voir cela le plus directement possible, c’est—à-dire au moment du changement de langue. En se mettant à écrire en allemand, Jean Beaufret introduit une rupture dont l’indication est aussi abrupte que claire. Le mot de cette rupture se trouve être la conjonction “insofern” — où s’entend le mot “fern” (“far”, *per. pevra. pro, c’est—à-dire les vecteurs les plus constants, dans nos langues, des tensions vers l’extrême lointain). Nous y reviendrons; mais pour le faire comme il faut, voyons d’abord quel est le cours de cette phrase qui, je le rappelle, commence en français.
La question de la technique, s’explique à lui‑même Jean Beaufret lisant et relisant la conférence “Die Frage nach der Technik”, est une question éminemment philosophique (et donc nullement un problème, susceptible d’être résolu anthropologiquement, sociologiquement, bref à l’aune de la science). En tant que question philosophique, cette question — où l’on est après à questionner la technique — renvoie d’abord à Aristote. Pourquoi cela? Parce que c’est lui qui définit [en 1439 b 15 de l’Éthique à Nicomaque], là où nous distinguons “art” et “artisanat”, l’unique visage de maîtrise que les Grecs nomment indifféremment: tevcnh. Il la définit comme la première modalité d’avérer, de “produire hors du retrait” — d’ajlhqeuvein comme écrit en toutes lettres Aristote. Par là, est dégagée la caractéristique formelle de toute technique: à savoir qu’elle a fondamentalement à voir avec l’histoire philosophique de la “vérité”, laquelle commence avec l’ajlhvqeia, telle que le monde hellénique en a fait à jamais nommément l’expérience.
Ici, ce que je ne faisais qu’indiquer en commençant trouve sa mise au clair: la technique a bien un commencement historique — au sens le plus fort du terme, qu’il est commode de marquer par le mot “historial” (dans l’acception précise où s’y entend que par ce type de commencement‑là, c’est toute une humanité qui devient par le fait partie prenante d’une destinée, laquelle se révèle adressée à ceux qui en seront expressément les destinataires, c’est—à-dire ceux qui auront à en porter la responsabilité). Avant ce commencement, il n’y a pas, à proprement parler de possibilité pour qu’apparaisse une “technique” dans l’acception stricte du terme. Pour qu’apparaisse une “technique”, il faut en effet qu’il y ait eu d’abord explicitation de la tevcnh — c’est—à-dire phénoménologie de ce qui rend possible toute fabrication humaine.
L’humanité n’a pas toujours connu la technique — ce constat ne doit pas nous faire perdre aussitôt notre sang‑froid, et nous porter à y soupçonner je ne sais quelle infamante arrière‑pensée “ethnocentriste”. Pour le dire vite, j’emprunte à Bergson ses termes: s’il vaut mieux parler d’abord d’homo faber plutôt que d’homo sapiens, rien ne serait pourtant plus égarant que d’identifier homo faber avec homo technicus. Tel est l’apport décisif de Heidegger: avoir compris qu’une mutation sans précédent a lieu avec l’apparition de la tevcnh grecque — mutation d’autant plus inapparente que rien ne semble distinguer, du point de vue de leur fabrication (j’aimerais presque dire: du point de vue de leur “finition”), rien ne distingue, je le répète, les œuvres grecques de n’importe quelle autre œuvre ayant vu le jour ailleurs. Partout où il y a hommes, des œuvres sortent de leurs mains, qui manifestent le caractère de haute gravité qui persiste dans tout être humain. L’apparition de l’homme grec n’est pas le commencement d’une humanité nouvelle. Mais c’est le moment où l’humanité devient, comme dirait Leibniz, “consciencieusement” elle‑même. Voilà bien pourquoi Heidegger insiste toujours: tevcnh est un terme dont l’acception première est celle d’un savoir. Mais en quel sens de “savoir”? La question doit être posée, car ce mot de “savoir” a une telle palette d’acceptions diverses que nous risquons de nous perdre si nous négligeons de le définir.
Prenons l’exemple du maître menuisier: il “sait” comment s’y prendre pour faire une table; or, à ce savoir, est premier le fait d’avoir d’avance en vue — d’avoir‑vu une fois pour toute — ce qu’il s’agit pour lui de faire être. La tevcnh est ainsi, pour l’homo faber, le moment où il devient en propre l’homme qui sait être faber, parce qu’il se sait être faber, et entend désormais ce que c’est qu’être, au premier chef, à partir de ce savoir‑là. Avec les philosophes, ce savoir devient thématiquement philosophique, ce qui pour nous veut dire: il suffit de lire Aristote pour voir comment la tevcnh est un savoir proprement éidétique — au sens où l’eido" de Socrate et Platon, le visage immuable, tel qu’il a été vu une fois pour toutes — configure une intelligibilité du savoir qui marque de fond en comble la visée propre à la tevcnh.
Résumons: poser la question de la technique renvoie à l’entente grecque de la tevcnh non pas historiographiquement, mais suivant une généalogie historiale d’intelligibilité. Mais cela n’implique nullement que la “technique” — ce que nous nommons de ce nom — soit la tevcnh grecque. Entre la tevcnh grecque et notre technique, il y a bien un rapport; mais ce rapport est lui‑même symptomatiquement inapparent.
Pour y faire apparaître un commencement de lisibilité, il faut remonter au‑delà d’Aristote. C’est exactement là que Jean Beaufret passe à l’autre langue, et son premier mot est “insofern”.
Comment traduire “insofern”? En remarquant d’abord qu’il répond à la question “in wie fern” — littéralement: en quelle mesure loin, à quelle distance de lointain? La question de la technique, dit Jean Beaufret, “par delà Aristote, remonte jusqu’à Héraclite”, insofern: “aussi loin que cela”. Ce lointain‑là, en effet, d’où parle Héraclite, quand commence à poindre l’expérience historiale de l’histoire, fait apparaître Héraclite à une incommensurablement plus grande distance d’Aristote qu’Aristote n’est lui- même distant de nous. C’est aussi loin qu’il faut remonter, s’il s’agit d’entrevoir ce qui, autrement, reste inapparent dans le rapport où viennent se lier entre elles “fabrication”, tevcnh et “technique”.
Pour sentir ce rapport historial, il faut d’abord avoir affronté ce que Jean Beaufret nomme “das Unaufhaltsame des Wesens der Technik”.
“Das Unaufhaltsame”: “Le caractère irrésistible” ai‑je traduit plus haut. Bien insuffisant, car il ne s’agit pas seulement d’une simple caractéristique. “Aufhalten”, c’est: retenir, arrêter, et plus particulièrement: arrêter quelque chose qui est en cours ou même en pleine course. “Das Unaufhaltsame”: ce qu’a de foncièrement inarrêtable, de réfractaire à tout endiguement, d’impossible à freiner ou refréner. Or ce qui se présente avec cette capacité de faire céder tous les efforts de blocage, c’est ce que Heidegger nomme: “das Wesen der Technik”.
Nous avons tendance à entendre cette locution comme désignant “l’essence de la technique”. Mais il vaut mieux quitter ce terrain — si du moins notre souci est de comprendre quelque chose à ce que Jean Beaufret est en train de découvrir en approfondissant sa lecture de Heidegger.
Car l’essence, ce que nous entendons sous ce nom, n’est autre que l’avatar, dans une philosophie devenue discipline d’école, de l’eido" — du visage immuable sous lequel se présente ce qui est quand le vise la tevcnh.
Lorsqu’il s’agit de comprendre — entendons bien: “comprendre” dans un sens plein, où ce n’est plus du tout la prise qui est au cœur de l’entreprise, mais bien, respectivement, la relation réciproque où s’entrecroisent et s’unissent ce qui est compris et ce qui le comprend — lorsqu’il s’agit de comprendre la technique, la prendre comme elle‑même s’y prend, c’est—à-dire en dégageant l’eido", n’est plus du tout de mise. En d’autres termes: lorsque Heidegger dit “das Wesen der Technik”, le mot “Wesen” n’a plus du tout l’acception traditionnelle d’essence.
Wesen est l’un de ces termes que Heidegger a écoutés avec la plus soutenue des attentions. Ce qu’il importe pour nous d’y comprendre, c’est que “Wesen” est un mot dont la résonnance est infiniment plus riche que celle d’un terme technique. “Das Wesen”, d’abord, est la pure et simple substantification du verbe “wesen”, lequel a connu, depuis le moyen—âge jusqu’à l’époque classique, un emploi très significatif dans la langue allemande. En particulier, ce verbe se signale par son aspect d’intense vivacité. Dans l’ancienne langue, il s’associe volontiers à deux autres verbes, “leben” (= vivre) et “wirken” (= être au travail) — de sorte qu’une locution comme: “lebet und weset und wirket” [il est en pleine vie et en plein travail] donne sur le champ un aperçu tout à fait prégnant de l’acception dans laquelle l’oreille allemande entend le mot “Wesen”. Je viens de le rendre tant bien que mal en combinant les deux verbes qui l’entourent: “leben” et “wirken”. Quand on évoque cette plénitude d’être en plein travail, et que l’on se la figure comme ne connaissant pas de cesse, on n’est pas trop loin, je crois, de ce qu’il s’agit de penser avec le mot “Wesen”, tel qu’invite à l’entendre Heidegger.
Le verbe “wesen”, cela mérite d’être remarqué, donne au prétérit du verbe “être”, sa forme: “war” (w.a.r) — exactement comme le radical indoeuropéen qui se retrouve dans le grec fuvsi" fournit au latin et au français la forme passée: fuit, il fut.