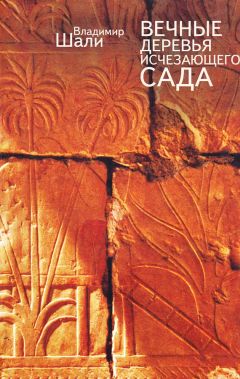Владимир Бибихин - Переписка 1992–2004
15 мая 2003
Тема: Poiesis: дело
Дорогая Ольга Александровна,
еще раз скажу, что сегодня снова целое утро читал Ваши вещи, и они вещи. Я стал больше понимать и поэтому меньше понимать. Всё сегодня было очень славно, Вы угадали своей одеждой цвет подаренного Вам букета[98].
Федье просит именно еще сегодня передать Вам его текст, о котором он говорит, что он тайно посвящен Вам.
Всего наилучшего вб
PS. Посылаю заодно и свой текст[99]
Приложение 1 APRÈS LA TECHNIQUELe titre de ma communication prête à équivoque; je vais donc commencer par en fixer le sens précis. Puis j’exposerai pourquoi il me paraît bon, par‑delà l’équivoque, d’aborder de cette manière la “question de la technique”.
“Après la technique”, voilà ce qui s’entend spontanément dans le sens de la succession, comme lorsqu'on dit: «après la pluie, le beau temps». Le titre ainsi compris, on s’attend à ce que soit envisagé: ce qui viendra après la technique.
Or ce n’est pas du tout ainsi qu’il faut entendre mon titre — et d’abord pour la simple raison qu’il n'y aura pas d’après la technique en ce sens‑là! Si la technique est bien un phénomène qui connaît incontestablement un “avant”, il ne peut y avoir un “après” elle (ce qui, à supposer que nous soyons suffisamment capables d’en appréhender l’indication, devrait déjà nous donner suffisamment à penser). Il n’y aura pas quelque chose pour faire suite à la technique parce qu’il s’agit avec cette dernière d’un phénomène éminent d’irréversibilité. Peut—être faudrait‑il d’emblée préciser que ce mot de “phénomène”, lui non plus, n’a pas ici l’acception courante d’événement manifestement extraordinaire. “Phénomène” doit s’entendre au contraire comme invite à le prendre Heidegger, c’est—à-dire comme: ce qui, pour parvenir pleinement en vue, requiert une phénoménologie — c’est- à—dire une pleine attention, axée notamment sur le souci qu’il convient de déployer pour accueillir non procustement ce qui demande à être pris en vue — pour s’y prendre avec lui sans le soumettre à un traitement qui le mutile (que ce soit par écartèlement ou par retranchement), de telle sorte qu’il puisse enfin, ce phénomène, apparaître tel qu’il est en lui‑même. En ce sens défini, le phénomène de la technique demande un type de questionnement lui‑même unique.
Plutôt que de nous occuper dès à présent du rapport de ce phénomène au temps, revenons‑en à ce qui motive le libellé de mon titre.
“Après”, en effet, n’y a pas l’acception du latin “post’ (ceci, puis cela); il garde son acception originale, celle de notre adverbe “auprès”. Ainsi entendu, “après” est comme l’indice d’un mouvement, et plus exactement encore: d’un mouvement de rapprochement; avec cette nuance importante que le mouvement s’efforce de parvenir à se rapprocher de ce dont, au départ, il est loin. Dans la langue populaire, laquelle parle sous l’urgence, qui se renouvelle heureusement en permanence, de redonner sans cesse à voir ce qui est dit, cette nuance est très présente. Dire: “courir après quelqu’un” signale d’emblée que la course en question a lieu relativement à quelqu’un qui, peu importe si c’est à dessein ou non, ne cesse de rester éloigné.
C’est pour rappeler une particularité apparemment peu notée du titre allemand de la conférence de Heidegger dont nous commémorons le cinquantenaire, que j’intitule ma communication “Après la technique”.
Cette conférence, prononcée le 18 novembre 1953, porte le titre: “Die Frage nach der Technik” — où “nach der Technik” a bien l’acception que je viens de dire: “après la technique” — dans la mesure où le questionnement s’y met en quête de la technique, phénomène auprès duquel, malgré les apparences, nous ne sommes pas du tout au départ.
Dans notre langue, parler de question conduit à ce que l’on formule: une question sur… (on s’interroge ainsi sur l’existence de Dieu, sur l’importance des ressources naturelles, etc.). En allemand, poser une question implique qu’elle soit formulée à l’aide de la préposition “nach”, laquelle dérive de l’adjectif “nah” (le “proche”), ce qui ouvre en quelque sorte la dimension où pourra éventuellement se produire une approche de ce que l’on cherche à connaître.
Toutes ces remarques seraient presque oiseuses si nous négligions d’y remarquer l’essentiel, à savoir que les langues parlent en suivant un certain esprit. Si nous sommes attentifs à l’indication que donne la langue allemande, nous pouvons commencer par entrevoir ceci: poser une question, ce n’est pas toujours simplement demander à ce que soient recueillis des renseignements à propos de ce sur quoi l’on s’informerait. Et pour passer au sujet qui nous occupe, ce pourrait être l’occasion de pressentir que la technique, la technique elle‑même n’est pas là sous nos yeux, immédiatement accessible et analysable comme un simple objet qu’il est loisible d’examiner, mais bien qu’elle échappe au type de prises que nous déployons habituellement pour saisir ce que nous avons sous les yeux, de sorte que questionner la technique impose dès le départ d’abandonner cette attitude familière, pour se mettre en route vers elle — et ne pas tarder à y faire une expérience, à savoir que cette démarche présente une allure hautement paradoxale, le moindre des paradoxes n’étant pas qu’aller vers elle ne diminue pas la distance qui nous en sépare. En d’autres termes: aller vers la technique, c’est devoir être après elle; mieux encore — si nous acceptons à notre tour de nous laisser guider nous aussi par l’esprit de notre langue — faisant droit à la vieille locution classique: devoir, vis à vis de la technique, être après à questionner… — entendons parler notre langue: être occupés à questionner — mettre tous nos soins, déployer toute notre attention pour prendre, face à la technique, la seule posture qui la laisse elle‑même venir d’elle‑même apporter les mots en lesquels elle va se phénoménaliser.
La question de la technique n’est pas une question facile. Non pas qu’elle impliquerait un déploiement d’enquêtes excédant les capacités que nous sommes individuellement en état de mettre en œuvre, mais tout simplement parce qu’elle demande un changement sans précédent du mode de questionnement.
Envisager ne serait‑ce qu’un changement quelconque, voilà qui ne va pas sans susciter quelque perturbation. Mais ce changement‑là, le changement du mode de questionnement, risque de bouleverser d’une manière si profonde, qu’il est prudent de commencer par s’y exercer pour ainsi dire du dehors (c’est—à-dire d’abord par des décalages formels) avant de l’entreprendre pour de bon.
À titre préparatoire, regardons le titre choisi par Heidegger lorsqu’il s’est agi de publier, en 1962, le texte du cours professé pendant le semestre d’hiver 1935/1936, et qui s’intitulait originalement: Questions fondamentales de la métaphysique.
Le livre de 1962 porte le titre: “Die Frage nach dem Ding”. Ce titre permet de vérifier ce que nous venons d’avancer. À première vue il donne à entendre que l’on s’y interroge sur ce qu’est une chose. Mais en réalité il invite à nous livrer à un exercice dont la pratique demande des qualités peu cultivées, l’exercice qui consiste à envisager face à face (si l’on ose dire) quelque chose qui ne cesse d’échapper; à savoir, dans le cas précis, le fait qu’une “chose” — ce que nous nommons “une chose”, et que les Allemands nomment “ein Ding” (les Anglais “a thing”) — il se pourrait bien, malgré toutes les découvertes techniques qui s’accumulent depuis des siècles, que nous en soyons beaucoup plus éloignés que nous ne pensons; si éloignés même, que nous ne pressentons plus guère ce que sont les choses, ce qu’elles sont, désormais, radicalement à notre insu (raison pour laquelle un malaise presque insupportable s’installe, à peine quelqu’un en vient‑il à simplement énoncer que ce que nous pensons aujourd’hui des choses nous barre l’accès à ce qu’elles sont en vérité).
Ce que sont les choses, Heidegger nous invitera plus tard à en apprendre le B, A, BA à même l’expérience la plus humble, en faisant paraître que la moindre des choses n’est vraiment que dans la mesure où, avec elle et en elle, est en cause et se rassemble le cadre entier non seulement de toutes les choses, mais de tout ce qui est.
Avant cette leçon de chose, on peut lire à la dernière page du livre publié en 1962 (dont on pourrait rendre le titre en disant Questionner après la chose):
«Nous avons dit plus haut que la question de la chose [die Dingfrage] était une question historiale; à présent nous voyons plus lisiblement à quel point il en est bien ainsi. La manière dont Kant questionne après la chose consiste à questionner après “intuitionner” et “penser”, après “l’expérience” et ses “principes”; ce qui signifie: cette question questionne après l’homme. La question: Qu’est‑ce qu’une chose? n’est autre que la question: Qui donc est l’être humain?
Mais cela n’implique pas que les choses soient de simples fabrications de l’ingéniosité humaine; tout au contraire, cela signifie: l’être humain doit être compris comme cet être qui, toujours déjà, saute d’emblée par‑delà les choses, mais de telle manière que sauter par‑delà les choses n’est possible que dans la mesure où les choses, tout en demeurant elles‑mêmes, viennent à la rencontre <de l’homme> — en ceci précisément qu’elles nous renvoient nous‑mêmes derrière nous, derrière tout ce qui, chez nous, en reste à la surface. Dans le questionnement kantien après la chose s’ouvre une dimension qui s’étend entre la chose et l’être humain, et dont l’étendue porte loin en avant par‑delà les choses, tout en portant à rebours bien derrière les êtres humains.»
Le style de Heidegger se reconnaît moins au vocabulaire qu’à la façon qu’il a de faire apparaître phénoménologiquement, par exemple: cette “dimension” dont il parle à la fin du texte que je viens de citer. Il me paraît important de souligner ce trait, parce que cela permet de saisir quelque chose qui, dans l’atmosphère asphyxiante de cloisonnement qui règne dans ce qui nous tient lieu de monde, échappe de plus en plus fatalement.
Cette dimension dont parle Heidegger — que dis‑je: cette dimension que nous voyons se déployer pour peu que nous aiguisions notre écoute en nous attachant à suivre ce qui est dit — d’autres, à leur manière à eux, l’on fait paraître. Ainsi (je n’en cite qu’un, mais quand on a l’attention avivée, on peut voir d’autres grands exemples où parallèlement vient s’exposer une manifestation comparable), ainsi, Henri Matisse, dans sa peinture, donne essor à ce qu’il nomme dans ses propos: “espace spirituel”, ou “espace cosmique”, “véritable espace plastique”, dont la spécificité consiste, dit‑il, à être un “espace vibrant”. Dans un propos rapporté par André Verdet[100], et datant de la fin de sa vie, Matisse déclare «Il y a aussi la question de l’espace vibrant.
Donner la vie à un trait, à une ligne, faire exister une forme, cela ne se résout pas dans les académies conventionnelles mais au dehors, dans la nature, à l’observation pénétrante des choses qui nous entourent.»
Dans un propos plus ancien[101] (datant de 1929), il exposait l’intention qui préside à son travail de peintre:
«Mon but est de rendre mon émotion. Cet état d’âme est créé par les objets qui m’entourent et qui réagissent en moi: depuis l’horizon jusqu’à moi‑même, y compris moi‑même. Car très souvent je me mets dans le tableau et j’ai conscience de ce qui existe derrière moi.»
Les mots ont beau n’être pas les mêmes, l’angle d’attaque des questions pointer dans des directions distinctes — une indéniable analogie d’inspiration anime le peintre et le philosophe: celle qui les oblige l’un comme l’autre à quitter l’ordre convenu de la représentation habituelle — à le quitter une fois pour toute, c’est—à-dire avec la conviction de ne jamais plus même pouvoir y revenir. Dans ce mouvement, il ne faut pas se le cacher, gît un risque considérable: perdre le contact des contemporains, ne plus du tout leur être intelligible. Non pas par souci de se singulariser en voulant à tout prix paraître “original”, mais sous une urgence entièrement autre, qui ne peut guère tomber sous le sens, puisqu’il s’agit désormais d’exister en rapport immédiat si possible à ce dont tire son origine ce que vous êtes, ce que vous faites aussi bien que le cadre entier de tout ce qui vous entoure.
Dans le cas de Heidegger, les vicissitudes de l’histoire ont encore accru ce risque, au point qu’il est facile de masquer sous l’apparence d’une candide bonne foi des critiques dont la motivation réelle est l’incapacité d’envisager ne serait‑ce que le plus infime changement des habitudes acquises.
La façon dont aujourd’hui encore, cinquante ans après que la conférence a été prononcée, on évacue communément ce que Heidegger a tenté de faire émerger concernant la technique; la légèreté avec laquelle le philistinisme intellectuel escamote son propos sous l’étouffoir qu’est la formule inepte de “technophobie” [je n’invente rien, hélas! — je me borne à citer], tout cela aurait de quoi stupéfier, si ne pouvait s’y repérer la source de ces gauchissements: la micrologie, sinon la misologie qui condamne à faire fi de tout ce qui ne se réduit pas aux schémas grâce auxquels on se meut confortablement là où il n’y a plus que des “problèmes” en attente de leur “solution”. Je ne souligne pas cette carence parce que je me laisserais emporter par un mouvement d’humeur. Rien ne doit être ici du ressort d’un simple affect. Quand il s’agit de penser, s’impose décidément dès le premier pas, d’avoir délaissé le terrain de l’opinion et des inclinations. Heidegger, face à la technique, ne s’abandonne pas à une “phobie”. Si tel était le cas, disons‑le tout net, il ne vaudrait pas la peine de nous en occuper un seul instant.
Se mettre en état de penser, demande de ceux qui l’entreprennent qu’ils mettent en œuvre une lucidité, un sang‑froid et une sobriété capables de balayer sans désemparer hors de leur horizon la masse de lieux communs, de figures de rhétorique et d’idées reçues qui forme le fonds de