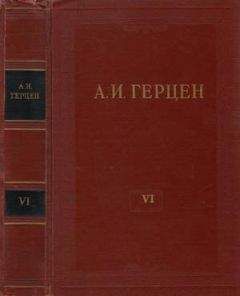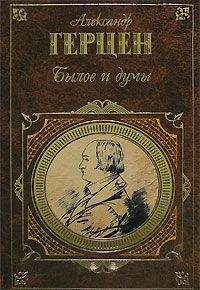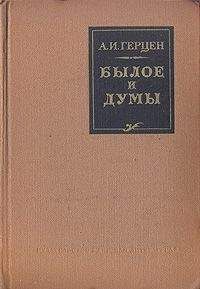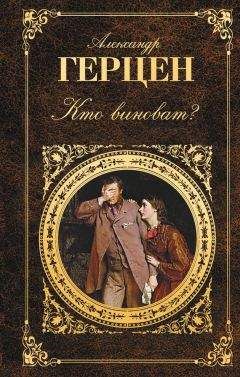Александр Герцен - Том 7. О развитии революционных идей в России
Les uns et les autres ont tenu leurs serments; les uns en allant mourir au gibet ou aux travaux forcés pour leurs idées; Alexandre en laissant la couronne à son frère Nicolas.
Les dix années qui s'écoulèrent depuis la rentrée des troupes jusqu'en 1825, forment l'apogée de l'époque de Pétersbourg. La Russie de Pierre Ier se sentait forte, jeune, pleine d'espérance. Elle pensait que la liberté pouvait s'inoculer avec la même facilité que la civilisation, et oubliait que celle-ci n'avait pas encore dépassé la surface et n'appartenait qu'à une très petite minorité. Cette minorité était en vérité développée au point qu'elle ne pouvait rester dans les conditions provisoires du régime impérial.
C'était la première opposition véritablement révolutionnaire qui se formait en Russie. L'opposition qu'avait rencontrée la civilisation, au commencement du XVIIIe siècle, était conservatrice. Celle même que faisaient quelques grands seigneurs, tels que le comte Panine, sous l'impératrice Catherine II, ne sortait pas du cercle des idées strictement monarchiques; elle était parfois énergique, mais toujours soumise et respectueuse. La direction qui s'empara des esprits après 1812 lut une tout autre. La collision entre le despotisme protecteur et la civilisation protégée devint imminente. Le premier combat qu'elles se livrèrent fut le 14 (26) décembre. L'absolutisme resta vainqueur; il montra alors quelle force il possédait pour le mal.
Le mot provisoire, que nous avons appliqué aux conditions du régime impérial, a pu paraître étrange, et pourtant il exprime le caractère qui frappe le plus, lorsqu'on envisage de près les actes du gouvernement russe. Ses institutions, ses lois, ses projets, tout en lui est évidemment temporaire, transitoire, sans être déterminé et sans forme définitive. Ce n'est pas un gouvernement conservateur, dans le sens du gouvernement autrichien, entre autres, parce qu'il n'a rien à conserver, à l'exception de sa force matérielle et de l'intégrité du territoire. lia débuté par une destruction tyrannique des institutions, des traditions, des mœurs, des lois, des coutumes du pays, et il continue par une série de bouleversements, sans acquérir de la stabilité et de la régularité.
Chaque règne met en question la majeure partie des droits et des institutions; on défend aujourd'hui ce qu'on ordonnait hier, on modifie, on varie, on abroge les lois: le code publié par Nicolas est la meilleure preuve du manque de principes et d'unité dans la législation impériale. Ce code présente la réunion de toutes |es lois existantes, c'est une juxtaposition d'ordonnances, de dispositions, d'oukases plus ou moins contradictoires qui expriment beaucoup mieux le caractère du prince ou l'intérêt du moment que l'esprit d'une législation unitaire. Le code du tzar Alexis sert de base, les ordonnances de Pierre Ier, conçues dans une tout autre tendance, servent de continuation: une loi de Catherine, dans l'esprit de Beccaria et de Montesquieu, s'y trouve à côté des ordres du jour de Paul Ier qui surpassent tout ce qu'on peut trouver de plus absurde et de plus arbitraire dans les édits des empereurs romains. Le gouvernement russe, comme tout ce qui n'a pas de racine historique, non seulement n'est pas conservateur, mais tout au contraire, il aime les innovations jusqu'à la folie. Il ne laisse rien en repos, et s'il améliore rarement, il change continuellement. C'est l'histoire des uniformes qu'on modiiie sans cesse et sans motif, pour les civils comme pour les militaires, passe-temps qui ne manquent pas de coûter des sommes immenses. C'est l'histoire du rebadigeonnage de vieux bâtiments, preuve de bon goût et du degré de la civilisation du gouvernement russe. Quelquefois on fait des révolutions entières en Russie, sans qu'on s'en aperçoive à l'étranger grâce au manque de publicité et au mutisme général. C'est ainsi qu'en 1838 on changea radicalement l'administration de toutes les communes rurales de l'empire. Le gouvernement s'immisça dans les affaires de la commune, il plaça chaque village sous une double surveillance de la police, Il commença une organisation forcée des travaux agricoles, il depouilla des communes et en enrichit d'autres, il établit enfin une administration nouvelle pour 17.000.000 d'hommes, sans que cet événement, qui a cependant presque toutes les dimensions une révolution, ait seulement transpiré en Europe.
Les paysans, craignant les cadastres et les interventions des agents publics, qu'ils connaissaient pour des pillards privilégies uniformés, s'insurgèrent dans beaucoup d'endroits. Dans quelques districts des gouvernements de Kazan, Viatka et Tambov, on est allé jusqu'à les mitrailler, et le nouvel ordre jut maintenu.
Un état pareil ne peut durer longtemps, et ce fut pour la première fois depuis 1812 qu'on commença à le sentir.
Le temps d'une association politique et secrète était parfaitement bien choisi, sous tous les rapports. La propagande littéraire était très active; le célèbre Ryléieff en était l'âme, lui et ses amis, ils ont imprimé à la littérature russe ce caractère d'énergie et d'entrain qu'elle n'a jamais eu ni avant ni après. Ce n'étaient pas seulement des paroles, c'étaient des actes. On voyait une résolution prise, un but certain, on ne s'abusait pas sur le danger, mais on marchait d'un pas ferme et la tête haute vers une solution irrévocable.
La littérature chez un peuple qui n'a point de liberté publique est la seule tribune, du haut de laquelle il puisse faire entendre le cri de son indignation et de sa conscience.
L'influence de la littérature dans une société ainsi faite acquiert des dimensions que celles des autres pays de l'Europe ont perdues depuis longtemps. Les poésies révolutionnaires de Ryléieff et de Pouchkine se trouvent entre les mains des jeunes gens dans les provinces les plus éloignées de l'empire. Il n'y a point de demoiselle bien élevée qui ne les connaisse par cœur, d'officier qui ne les porte dans son havresac, pas de fils de prêtre qui n'en eût fait une douzaine de copies. Ces dernières années, cette ardeur s'est de beaucoup refroidie, parce qu'elles ont produit leur impression; toute une génération a subi l'influence de cette propagande jeune et ardente.
La conjuration se répandait avec célérité à Pétersbourg, à Moscou, dans la Petite-Russie, parmi les officiers de la garde et de la 2e armée. Les Russes indolents, tant qu'ils ne trouvent pas d'impulsions, sont faciles à se laisser entraîner. Une fois entraînés, ils vont aux dernières conséquences sans chercher d'accommodement.
Depuis Pierre Ier on a beaucoup parlé de la faculté d'imitation que les Russes poussaient jusqu'au ridicule. Quelques savants Allemands prétendaient que les Slaves fussent dénués de tout caractère propre, que leur qualité distinctive se bornât à l'acceptivité. En effet la nationalité slave a une grande élasticité; un fois sortie de l'exclusivisme patriotique, elle ne trouve plus d'obstacle infranchissable pour comprendre les autres nationalites. La science allemande qui ne passe pas le Rhin, et la poésie anglaise, qui s'altère en traversant le Pas-de-Calais, ont acquis, il y a longtemps, le droit de cité chez les Slaves. Il faut ajouter à cela, qu'au fond de cette acceptivité des Slaves, il y a quelque chose d'original qui, tout en se prêtant aux influences extérieures, conserve son propre caractère.
Nous retrouvons ce trait de l'esprit russe dans la marche de la conjuration qui nous occupe. Au commencement, elle eut une tendance constitutionnelle, libérale dans le sens anglais. Mais à peine cette opinion fut-elle acceptée, que l'association se transforma, elle devint plus radicale, à la suite de quoi beaucoup de membres l'abandonnèrent. Le noyau des conjurés se fit républicain et no voulut plus se contenter d'une monarchie représentative. Ils pensaient avec raison que s'ils avaient assez de force pour limiter l'absolutisme, ils en auraient assez pour l'anéantir. Les chefs de l'union du Sud avaient en vue une fédéralisation' républicaine des Slaves, ils travaillaient à une dictature révolutionnaire qui devait organiser les formes républicaines.
Il y avait plus; lorsque le colonel Pestel vint en visite à la Société du Nord, il plaça la question sur un autre terrain. Il pensa que la proclamation de la république n'avancerait rien si l'on n'entraînait pas la propriété foncière dans la révolution. N'oublions pas qu'il s'agit ici des faits qui se sont passés entre 1817 et 1825. Les questions sociales n'occupaient alors personne en Europe, Gracchus Babœuf, «le fou, le sauvage» était déjà oublié, Saint-Simon écrivait ses traités, mais personne ne les lisait; Fourier était dans le même cas, les essais d'Owen n'intéressaient pas davantage. Les plus grands libéraux de ces temps, les Benjamin Constant, les P. L. Courier auiaient jeté des cris d'indignation en entendant les propositions de Pestel, propositions qui ne se taisaient pas dans un club composé de prolétaires, mais devant une grande association totalement formée de la noblesse la plus riche. Pestel lui proposait d'arriver, au prix de leur vie, à l'expropriation de leurs biens. On ne s'accordait pas avec lui, ses opinions bouleversaient trop les principes de l'économie politique qu'on venait à peine d'apprendre. Mais on ne l'accusait pas de vouloir le pillage et le massacre; Pestel restait néanmoins le véritable chef de l'association du Sud, et il est plus que probable, qu'en cas de succès, il serait devenu dictateur, lui qui était socialiste avant le socialisme.
Pestel n'était ni rêveur, ni utopiste; tout au contraire, il était complètement dans la réalité, il connaissait l'esprit de sa nation. En laissant les terres à la noblesse, on aurait obtenu une oligarchie, le peuple n'aurait même pas compris son affranchissement, le paysan russe ne voulant être libre qu'avec sa terre.
Ce fut encore Pestel qui pensa le premier à faire participer le peuple à la révolution. Il était d'accord avec ses amis que l'insurrection ne pouvait réussir sans l'appui de l'armée, mais il voulait aussi entraîner à toute force les sectaires religieux, projet profond dont la justesse et la portée seront prouvées par l'avenir.
Après coup, nous pouvons dire que Pestel se faisait illusion: ni ses amis ne pouvaient travailler à une révolution sociale, ni le peuple faire cause commune avec la noblesse; mais il n'est donné qu'aux grands hommes de se tromper de la sorte en anticipant sur le développement des masses.
Il se trompait en pratique, de date, mais théoriquement, il faisait une révélation. Il était prophète, et toute l'association fut une immense école pour la génération présente.
Le 14 (26) décembre a réellement ouvert une nouvelle phase à notre éducation politique, et ce qui peut paraître étrange, la grande intluence que cette œuvre a eue et qui a agi plus que la propagande et plus que les théories, fut le soulèvement même, la conduite héroïque des conjurés sur la place publique, pendant le procès, dans les fers, en présence de l'empereur Nicolas, dans les mines, en Sibérie. Ce qui manquait aux Russes, ce n'étaient ni les tendances libérales, ni la conscience des abus, il leur manquait un précédent qui leur donnât l'audace de l'initiative. Les théories inspirent des convictions, l'exemple forme la conduite. Nulle part un pareil exemple n'est plus nécessaire que là où l'homme n'est pas habitué à poursuivre sa volonté, à se mettre en évidence, à compter sur lui-même et à estimer ses forces, où au contraire il a toujours été mineur, sans voix et sans opinion, abrité derrière la commune comme derrière une enceinte infranchissable absorbé par l'Etat dans lequel il était comme perdu. Avec la civilisation les idées de liberté s'étaient développées nécessairement, mais le mécontentement passif était trop entré dans les habitudes; on voulait sortir du despotisme, mais personne ne voulait être le premier à le faire.
Eh bien, les premiers se présentèrent avec une grandeur d'âme et une force de caractère telles, que le gouvernement, dans son rapport officiel, n'osa ni les abaisser ni les flétrir; Nicolas se borna à les punir avec férocité. Le silence, la passivité muette étaient rompus; du haut de leur gibet, ces hommes réveillèrent l'âme de la nouvelle génération, un bandeau tomba des yeux.
L'action du 14 décembre sur le gouvernement même ne fut pas moins décisive; de Pierre à Nicolas, le gouvernement avait tenu haut le drapeau du progrès et de la civilisation; dès l'année 1825, rien de pareil; le pouvoir ne songe qu'à ralentir le mouvement intellectuel, ce n'est plus le mot de progrès qu'on inscrit sur la bannière impériale, mais les mots: «autocratie, orthodoxie, nationalité», ce mane, fare, takel du despotisme, et de plus les deux derniers mots n'étaient là que pour la forme. Religion, patriotisme, ce n'étaient que les moyens pour raffermir l'autocratie, le peuple n'a jamais été dupe du nationalisme de Nicolas; le grand mot qui exprime son règne c'est le despotisme disant: «périsse la Russie, pourvu que le pouvoir reste illimité et intact». Avec cette devise sauvage plus de malentendu, et ce fut encore le 14 décembre qui força le gouvernement à quitter l'hypocrisie et à arborer le despotisme.
Peu avant le sombre règne qui commença dans le sang russe et qui continua dans le sang polonais, parut le grand poète russe Pouchkine, et dès qu'il parut, il devint nécessaire, comme si la littérature russe ne pouvait se passer de lui. On a lu les autres poètes, on les a admirés, Pouchkine est dans les mains de chaque Russe civilisé, qui le relit toute sa vie. Sa poésie n'est plus ni ua essai ni une étude, ni un exercice, c'était sa vocation, et elle devint un art mûr; la partie civilisée de la nation russe trouva en lui, pour la première fois, le don de la parole poétique.
Pouchkine est on ne peut plus national et en même temps intelligible aux étrangers. Il contrefait rarement la langue populaire des chansons russes, il exprime sa pensée telle qu'elle surgit dans son esprit. Comme tous les grands poètes, il est toujours au niveau de son lecteur, il grandit, devient sombre, orageux, tragique, son vers mugit comme la mer, comme la iorêt agitée par une tempête, mais il est en même temps serein, limpide, pétillant, avide de plaisirs, d'émotions. Partout, le poète russe est réel, rien en lui de maladif, rien de cette pathologie psychologique exagérée, de ce spiritualisme chrétien abstrait, qu'on voit si souvent dans les poètes allemands. Sa muse n'est pas un être pâle, aux nerfs attaqués, roulé dans un linceul, c'est une femme ardente, entourée de l'auréole de la santé, trop riche de sentiments véritables pour en chercher de factices, assez malheureuse pour ne pas inventer de malheurs artificiels. Pouchkine avait la nature panthéiste, épicurienne des poètes grecs, mais il y avait encore dans son âme un élément tout moderne. En se repliant sur lui-même, il trouvait au fond de son âme la pensée amère de Byron, l'ironie corrosive de notre siècle.