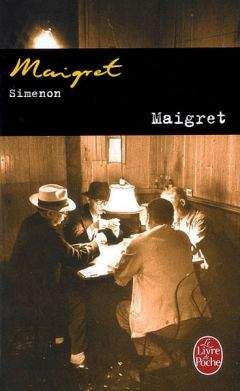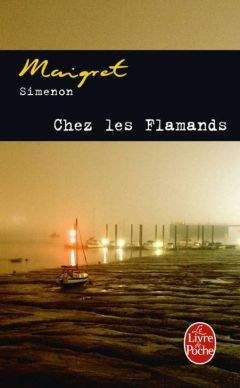Simenon, Georges - Maigret aux assises
À la table des journalistes, on se regardait, puis on regardait le magistrat avec surprise.
— Je suppose que le compagnon auquel vous faites allusion n’est pas Alfred Meurant ?
— Non, monsieur le Président. Hier, dans mon bureau, où j’ai convoqué Nicolas Cajou et la femme de chambre, je leur ai montré plusieurs centaines de fiches anthropométriques afin de m’assurer que le compagnon de Ginette Meurant n’est pas de nos connaissances. L’homme est de petite taille, trapu, les cheveux très bruns. Il est vêtu avec recherche et porte au doigt une bague avec une pierre jaune. Il serait âgé d’une trentaine d’années et il fume des cigarettes américaines qu’il allume à la chaîne, de sorte qu’après chacune de ses visites rue Victor-Massé on retrouvait un plein cendrier de mégots dont quelques-uns seulement étaient tachés de rouge à lèvres.
« Je n’ai pas eu le temps matériel, avant le procès, d’entreprendre une enquête approfondie. Nicolas Cajou est entré à l’hôpital le 26 février. Le 25, il se tenait encore au bureau de l’hôtel et il affirme qu’il a reçu, ce jour-là, la visite du couple.
Un remous se produisait dans la salle, qui restait invisible à Maigret, et le président haussait le ton, ce qui lui arrivait rarement, pour prononcer :
— Silence, ou je fais évacuer.
Une voix de femme tentait de se faire entendre :
— Monsieur le Président, je...
— Silence !
Quant à l’accusé, les mâchoires serrées, il regardait Maigret avec haine.
CHAPITRE III
Personne ne bougea pendant que le président se penchait tour à tour vers ses assesseurs et leur parlait à voix basse. Un colloque à trois s’engageait, qui rappelait aussi des rites religieux car on voyait les lèvres remuer sans bruit comme pour des répons, les visages s’incliner à une curieuse cadence. Un moment vint où l’avocat général en robe rouge quitta son siège pour prendre langue à son tour et on put croire, un peu plus tard, que le jeune défenseur allait en faire autant. Il hésitait visiblement, inquiet, pas encore assez sûr de lui, et il était presque debout quand le président Bernerie frappa le banc de son marteau et quand chaque magistrat reprit sa place comme dans un tableau.
Xavier Bernerie récitait du bout des lèvres :
— La Cour remercie le témoin de sa déposition et le prie de ne pas quitter le tribunal.
Toujours comme un officiant il cherchait sa toque de la main, la saisissant et, se mettant debout, achevait son répons.
— L’audience est suspendue pour un quart d’heure.
Ce fut, d’une seconde à l’autre, un bruit de récréation, presque une explosion, à peine assourdie, des sons de toutes sortes qui se mélangeaient. La moitié des spectateurs quittaient leur place ; certains, debout dans les traverses, gesticulaient, d’autres se bousculaient en s’efforçant d’atteindre la grande porte que les gardes venaient d’ouvrir tandis que les gendarmes escamotaient l’accusé par une issue qui se confondait avec les panneaux des murs, que Pierre Duché suivait non sans peine et que les jurés, de l’autre côté, disparaissaient, eux aussi, dans la coulisse.
Des avocats en robe, surtout des jeunes, une avocate qui aurait pu figurer sur la couverture d’un magazine, formaient une grappe noire et blanche près de l’entrée des témoins. On y discutait les articles 310, 311, 312 et la suite du code de procédure criminelle et certains parlaient avec excitation d’irrégularité dans le déroulement des débats qui conduiraient infailliblement l’affaire en cassation.
Un vieil avocat aux dents jaunes, à la robe luisante, une cigarette non allumée pendant à sa lèvre inférieure, invoquant calmement la jurisprudence, citait deux cas. l’un à Limoges, en 1885 l’autre à Poitiers, en 1923, où, non seulement l’instruction avait été entièrement refaite à l’audience publique, mais où elle avait pris une direction nouvelle à la suite d’un témoignage inattendu.
De tout cela, Maigret, bloc immobile, ne voyait que des images bousculées, n’entendait que des bribes, et il n’avait eu le temps de repérer, dans la salle où se créaient quelques vides, que deux de ses hommes, quand il fut cerné par les journalistes.
La même surexcitation régnait qu’au théâtre, à une générale, après le premier acte.
— Que pensez-vous de la bombe que vous venez de lancer, monsieur le commissaire ?
— Quel bombe ?
Il bourrait méthodiquement sa pipe et il avait soif.
— Vous croyez Meurant innocent ?
— Je ne crois rien.
— Vous soupçonnez sa femme ?
— Messieurs, ne m’en veuillez pas si je n’ai rien à ajouter à ce que j’ai dit à la barre.
Si la meute le laissait soudain en paix, c’est qu’un jeune reporter s’était précipité sur Ginette Meurant qui s’efforçait de gagner la sortie et que les autres craignaient de rater une déclaration sensationnelle.
Tout le monde regardait le groupe mouvant. Maigret en profitait pour se glisser par la porte des témoins, retrouvait, dans le couloir, des hommes qui fumaient une cigarette, d’autres qui, peu familiers de l’endroit, cherchaient les urinoirs.
Il savait que les magistrats délibéraient dans la chambre du président et il vit un huissier y conduire le jeune Duché qu’on avait fait appeler.
Midi approchait. Bernerie voulait évidemment en finir avec l’incident à l’audience du matin, afin de reprendre, l’après-midi, le cours régulier des débats, espérant un verdict le jour même.
Maigret atteignait la galerie, allumait enfin sa pipe, adressait un signe à Lapointe qu’il apercevait adossé à un pilier.
Il n’était pas le seul à vouloir mettre la suspension à profit pour boire un verre de bière. On voyait des gens, dehors, le col relevé, qui traversaient la rue en courant sous la pluie pour s’engouffrer dans les cafés d’alentour.
À la buvette du Palais, une foule impatiente, sous pression, dérangeait les avocats et leurs clients qui, quelques instants plus tôt, discutaient en paix de leurs petites affaires.
— Bière ? demandait-il à Lapointe.
— Si on y arrive, patron.
Ils se poussaient entre les dos et les coudes. Maigret faisait signe à un garçon qu’il connaissait depuis vingt ans et, quelques instants plus tard, on lui passait par-dessus les têtes deux demis bien mousseux.
— Tu t’arrangeras pour savoir où elle déjeune, avec qui, à qui elle parle, le cas échéant, à qui elle téléphone.
La marée se renversait déjà et des gens couraient pour reprendre leur place. Quand le commissaire atteignit le prétoire, c’était trop tard pour gagner les rangées de bancs et il dut rester contre la petite porte, parmi les avocats.
Les jurés étaient à leur poste, l’accusé aussi, entre ses gardes, son défenseur en contrebas devant lui. La Cour entrait et s’asseyait dignement, consciente, sans doute, comme le commissaire, du changement qui s’était produit dans l’atmosphère.
Tout à l’heure, il était question d’un homme accusé d’avoir tranché la gorge de sa tante, une femme de soixante ans, et d’avoir étouffé, après avoir tenté de l’étrangler, une petite fille de quatre ans. N’était-ce pas naturel qu’il y eût dans l’air une gravité morne et un peu étouffante ?
Maintenant, après l’entracte, tout était changé. Gaston Meurant était passé au second plan et le double crime même avait perdu de son importance. Le témoignage de Maigret avait introduit un nouvel élément, posé un nouveau problème, équivoque, scandaleux, et la salle ne s’intéressait plus qu’à la jeune femme que les occupants des derniers rangs essayaient en vain d’apercevoir.
Cela créait une rumeur particulière et on vit le président promener un regard sévère sur la foule, avec l’air de chercher des yeux les perturbateurs. Cela dura très longtemps et, à mesure que le temps passait, les bruits s’assourdissaient, mouraient tout à fait, le silence reprenait son règne.
— J’avertis le public que je ne tolérerai aucune manifestation et qu’au premier incident je ferai évacuer la salle.
Il toussotait, murmurait quelques mots à l’oreille de ses assesseurs.
— En vertu des pouvoirs discrétionnaires qui me sont conférés et en accord avec l’avocat général ainsi qu’avec la défense, j’ai décidé d’entendre trois témoins nouveaux. Deux se trouvent dans la salle et le troisième, la nommée Geneviève Lavaucher, touchée par une convocation téléphonique, se présentera à l’audience de cet après-midi. Huissier, veuillez appeler Mme Ginette Meurant.
Le vieil huissier s’avança, dans l’espace vide, à la rencontre de la jeune femme, qui, assise au premier rang, se levait, hésitait, puis se laissait conduire vers la barre.
Maigret l’avait entendue plusieurs fois quai des Orfèvres. Il avait eu alors devant lui une petite femme à la coquetterie vulgaire et parfois agressive.
En l’honneur des Assises, elle s’était acheté un ensemble tailleur noir, jupe et manteau trois-quarts, la seule tache de couleur était donnée par le chemisier jaune paille.
Pour la circonstance aussi, le commissaire en était persuadé, pour soigner son personnage elle portait un chapeau genre chapelier qui donnait un certain mystère à son visage.
On aurait dit qu’elle jouait à la fois la petite fille naïve et la petite-madame-très-comme-il-faut, baissant la tête, la relevant pour fixer le président des yeux peureux et dociles.
— Vous vous appelez Ginette Meurant, née Chenault ?
— Oui, monsieur le Président.
— Parlez plus fort et tournez-vous vers messieurs les jurés. Vous avez vingt-sept ans et vous êtes née à Saint-Sauveur dans la Nièvre.
— Oui, monsieur le Président.
— Vous êtes l’épouse de l’accusé ?
Elle répondait toujours de la même voix de bonne élève.
— En vertu de l’article 322, votre déposition ne peut être reçue mais, d’accord avec le ministère public et avec la défense, la Cour a le droit de vous entendre à titre d’information.
Et, comme elle levait la main à l’imitation des précédents témoins, il l’arrêtait.
— Non ! Vous ne devez pas prêter serment.
Maigret entrevoyait entre deux têtes le visage pâle de Gaston Meurant qui, le menton dans les mains, regardait fixement devant lui. De temps en temps, ses mâchoires se serraient si fort qu’elles faisaient saillie.
Sa femme évitait de se tourner vers lui, comme si cela lui eût été défendu, et c’était toujours au président qu’elle se raccrochait des yeux.
— Vous connaissiez la victime, Léontine Faverges ?
Elle semblait hésiter avant de murmurer :
— Pas très bien.
— Que voulez-vous dire ?
— Qu’elle et moi ne nous fréquentions pas.
— Vous l’avez cependant rencontrée ?
— Une première fois, avant notre mariage. Mon fiancé avait insisté pour me présenter à elle en disant que c’était sa seule famille.
— Vous êtes donc allée rue Manuel ?
— Oui. L’après-midi, vers cinq heures. Elle nous a servi du chocolat et des gâteaux. J’ai senti tout de suite qu’elle ne m’aimait pas et qu’elle conseillerait à Gaston de ne pas m’épouser.
— Pour quelle raison ?
Elle haussa les épaules, chercha ses mots, trancha enfin :
— Nous n’étions pas du même genre.
Un regard du président arrêtait les rires au bord des lèvres.
— Elle n’a pas assisté à votre mariage ?
— Si.
— Et Alfred Meurant, votre beau-frère ?
— Lui aussi. À cette époque-là, il vivait à Paris et n’était pas encore brouillé avec mon mari.
— Quelle profession exerçait-il ?
— Représentant de commerce.
— Il travaillait régulièrement ?
— Comment le saurais-je ? Il nous a offert un service à café comme cadeau de mariage.
— Vous n’avez pas revu Léontine Faverges ?
— Quatre ou cinq fois.
— Elle est venue chez vous ?
— Non. C’est nous qui allions chez elle. Je n’en avais pas envie, car j’ai horreur de m’imposer aux gens qui ne m’aiment pas, mais Gaston prétendait que je ne pouvais pas faire autrement.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas.
— N’était-ce pas, par hasard, à cause de son argent ?
— Peut-être.
— À quel moment avez-vous cessé de fréquenter la rue Manuel ?
— Il y a longtemps.
— Deux ans ? Trois ans ? Quatre ans ?
— Mettons trois ans.
— Vous connaissiez donc l’existence du vase chinois qui se trouvait dans le salon ?
— Je l’ai vu et j’ai même dit à Gaston que les fleurs artificielles ce n’est bien que pour les couronnes mortuaires.
— Vous saviez ce qu’il contenait ?
— Je n’étais au courant que des fleurs.
— Votre mari ne vous a jamais rien dit ?
— Au sujet de quoi ? Du vase ?
— Des pièces d’or.
Pour la première fois, elle se tourna vers le box des accusés.
— Non.
— Il ne vous a pas confié non plus que sa tante, au lieu de déposer son argent à la banque, le gardait chez elle ?
— Je ne m’en souviens pas.
— Vous n’en êtes pas sûre ?
— Si... Oui...
— À l’époque où vous fréquentiez encore, si peu que ce soit, la rue Manuel, la petite Cécile Perrin était-elle déjà dans la maison ?
— Je ne l’ai jamais vue. Non. Elle aurait été trop petite.
— Vous avez entendu parler d’elle par votre mari ?
— Il a dû y faire allusion. Attendez ! J’en suis certaine, à présent. Même que cela m’a étonnée qu’on confie une enfant à une femme comme elle.
— Saviez-vous que l’accusé allait assez fréquemment demander de l’argent à sa tante ?
— Il ne me tenait pas toujours au courant.
— Mais d’une façon générale, vous le saviez ?
— Je savais qu’il n’était pas fort en affaires, qu’il se laissait rouler par tout le monde, comme quand nous avons ouvert, rue du Chemin-Vert, un restaurant qui aurait pu très bien marcher.
— Que faisiez-vous dans le restaurant ?
— Je servais les clients.
— Et votre mari ?
— Il travaillait dans la cuisine, aidé par une vieille femme,
— Il s’y connaissait ?
— Il se servait d’un livre.
— Vous étiez seule dans la salle avec les clients ?
— Au début, nous avions une jeune serveuse.
— Lorsque l’affaire a mal tourné, Léontine Faverges n’a-t-elle pas aidé à désintéresser les créanciers ?
— Je suppose. Je crois qu’on doit encore de l’argent.
— Votre mari, les derniers jours de février, paraissait-il tracassé ?
— Il se tracassait toujours.
— Vous a-t-il parlé d’une traite venant à échéance le 28 ?
— Je n’y ai pas fait attention. Il y avait des traites tous les mois.
— Il ne vous a pas annoncé qu’il irait voir sa tante pour lui demander de l’aider une fois de plus ?
— Je ne m’en souviens pas.
— Cela ne vous aurait pas frappée ?
— Non. J’en avais l’habitude.
— Après la liquidation du restaurant, vous n’avez pas proposé de travailler ?