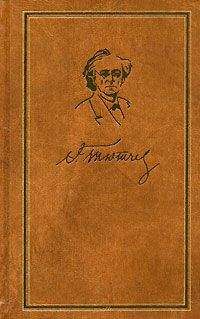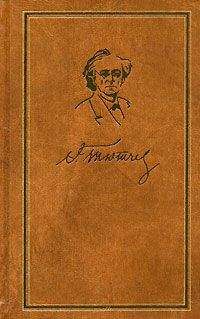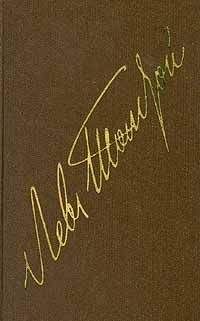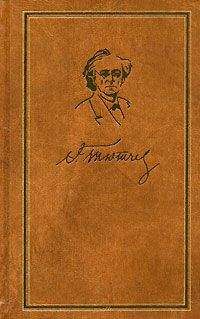Федор Тютчев - Том 3. Публицистические произведения
Et lorsque au-dessus de cet immense naufrage nous voyons comme une Arche Sainte surnager cet Empire plus immense encore, qui donc pourrait douter de sa mission, et serait-ce à nous, ses enfants, à nous montrer sceptiques et pusillanimes?..
12 avril 1848
La question Romaine*
Si, parmi les questions du jour ou plutôt du siècle, il en est une qui résume et concentre comme dans un foyer toutes les anomalies, toutes les contradictions et toutes les impossibilités contre lesquelles se débat l’Europe Occidentale, c’est assurément la question romaine.
Et il n’en pouvait être autrement, grâce à cette inexorable logique que Dieu a mise, comme une justice cachée, dans les événements de ce monde. La profonde et irréconciliable scission qui travaille depuis des siècles l’Occident, devait trouver enfin son expression suprême, elle devait pénétrer jusqu’à la racine de l’arbre. Or, c’est un titre de gloire que personne ne contestera à Rome: elle est encore de nos jours, comme elle l’a toujours été, la racine du monde occidental. Il est douteux toutefois, malgré la vive préoccupation que cette question suscite, qu’on se soit rendu un compte exact de tout ce qu’elle contient.
Ce qui contribue probablement à donner le change sur la nature et sur la portée de la question telle qu’elle vient de se poser, c’est d’abord la fausse analogie de ce que nous avons vu arriver à Rome avec certains antécédents de ses révolutions antérieures; c’est aussi la solidarité très réelle qui rattache le mouvement actuel de Rome au mouvement général de la révolution européenne. Toutes ces circonstances accessoires, qui paraissent expliquer au premier abord la question romaine, ne servent en réalité qu’à en dissimuler la profondeur.
Non, certes, ce n’est pas là une question comme une autre — car non seulement elle touche à tout dans l’Occident, mais on peut même dire qu’elle le déborde.
On ne serait assurément pas accusé de soutenir un paradoxe ou d’avancer une calomnie en affirmant qu’à l’heure qu’il est, tout ce qui reste encore de Christianisme positif à l’Occident, se rattache, soit explicitement, soit par des affinités plus ou moins avouées, au Catholicisme Romain dont la Papauté, telle que les siècles l’ont faite, est évidemment la clef de voûte et la condition d’existence.
Le Protestantisme avec ses nombreuses ramifications, après avoir fourni à peine une carrière de trois siècles, se meurt de décrépitude dans tous les pays où il avait regné jusqu’à présent, l’Angleterre seule exceptée; — ou s’il révèle encore quelques éléments de vie, ces éléments aspirent à rejoindre Rome. Quant aux doctrines religieuses qui se produisent en dehors de toute communauté avec l’un ou l’autre de ces deux symboles, ce ne sont évidemment que des opinions individuelles.
En un mot: la Papauté — telle est la colonne unique qui soutient tant bien que mal en Occident tout ce pan de l’édifice chrétien resté debout après la grande ruine du seizième siècle et les écroulements successifs qui ont eu lieu depuis. Maintenant c’est cette colonne que l’on se dispose à attaquer par sa base.
Nous connaissons fort bien toutes les banalités, tant de la presse quotidienne que du langage officiel de certains gouvernements, dont on a l’habitude de se servir pour masquer la réalité: on ne veut pas toucher à l’institution religieuse de la Papauté, — on est à genoux devant elle, — on la respecte, on la maintiendra, — on ne conteste même pas à la Papauté son autorité temporelle, — on prétend seulement en modifier l’exercice. On ne lui demandera que des concessions reconnues indispensables et on ne lui imposera que des réformes parfaitement légitimes. Il y a dans tout ceci passablement de mauvaise foi et surabondamment d’illusions.
Il y a certainement de la mauvaise foi, même de la part des plus candides, à faire semblant de croire que des réformes sérieuses et sincères, introduites dans le régime actuel de l’Etat Romain, puissent ne pas aboutir dans un temps donné à une sécularisation complète de cet Etat.
Mais la question n’est même pas là: la véritable question est de savoir au profit de qui se ferait cette sécularisation, c’est-à-dire quels seront: la nature, l’esprit et les tendances du pouvoir auquel vous remettriez l’autorité temporelle après en avoir dépouillé la Papauté? — Car, vous ne sauriez vous le dissimuler, c’est sous la tutelle de ce nouveau pouvoir que la Papauté serait désormais appelée à vivre.
Et c’est ici que les illusions abondent. Nous connaissons le fétichisme des Occidentaux pour tout ce qui est forme, formule et mécanisme politique. Ce fétichisme est devenu comme une dernière religion de l’Occident; mais, à moins d’avoir les yeux et l’esprit complètement fermés et scellés a toute expérience comme à toute évidence, comment, après ce qui vient de se passer, parviendrait-on encore à se persuader que dans l’état actuel de l’Europe, de l’Italie, de Rome, les institutions libérales ou semi-libérales que vous aurez imposées au Pape resteraient longtemps aux mains de cette opinion moyenne, modérée, mitigée, telle que vous vous plaisez à la rêver dans l’intérêt de votre thèse, qu’elles ne seraient point promptement envahies par la révolution et transformées aussitôt en machines de guerre pour battre en brèche, non pas seulement la souveraineté temporelle du Pape, mais bien l’institution religieuse elle-même. Car vous auriez beau recommander au principe révolutionnaire, comme l’Eternel à Satan, de ne molester que le corps du fidèle Job sans toucher à son âme, soyez bien convaincus que la révolution, moins scrupuleuse que l’ange des ténèbres, ne tendrait nul compte de vos injonctions.
Toute illusion, toute méprise à cet égard sont impossibles pour qui a bien réellement compris ce qui fait le fond du débat qui s’agite en Occident — ce qui en est devenu depuis des siècles la vie même; vie anormale mais réelle, maladie qui ne date pas d’hier et qui est toujours encore en voie de progrès. Et s’il se rencontre si peu d’hommes qui ont le sentiment de cette situation, cela prouve seulement que la maladie est déjà bien avancée.
Nul doute, quant à la question romaine, que la plupart des intérêts qui réclament des réformes et des concessions de la part du Pape sont des intérêts honnêtes, légitimes et sans arrière-pensée; qu’une satisfaction leur est due et que même elle ne saurait leur être plus longtemps refusée. Mais telle est l’incroyable fatalité de la situation, que ces intérêts d’une nature toute locale et d’une valeur comparativement médiocre dominent et compromettent une question immense. Ce sont de modestes et inoffensives habitations de particuliers situées de telle sorte qu’elles commandent une place de guerre et, malheureusement, l’ennemi est aux portes.
Car encore une fois la sécularisation de l’Etat romain est au bout de toute réforme sincère et sérieuse qu’on voudrait y introduire, et d’autre part la sécularisation dans les circonstances présentes ne serait qu’un désarmement devant l’ennemi — une capitulation…
Eh bien, qu’est-ce à dire? que la question romaine posée dans ces termes est tout bonnement un labyrinthe sans issue; que l’institution papale par le développement d’un vice caché en est arrivée après une durée de quelques siècles à cette période de l’existence où la vie, comme on l’a dit, ne se faisait plus sentir que par une difficulté d’être? Que Rome qui a fait l’Occident à son image se trouve comme lui acculée à une impossibilité? Nous ne disons pas le contraire…
Et c’est ici qu’éclate visible comme le soleil cette logique providentielle qui régit comme une loi intérieure les événements de ce monde.
Huit siècles seront bientôt révolus depuis le jour où Rome a brisé le dernier lien qui la rattachait à la tradition orthodoxe de l’Eglise universelle. — Ce jour-là Rome en se faisant une destinée à part a décidé pour des siècles de celle de l’Occident.
On connaît généralement les différences dogmatiques qui séparent Rome de l’Eglise orthodoxe. Au point de vue de la raison humaine cette différence, tout en motivant la séparation, n’explique pas suffisamment l’abîme qui c’est creusé non pas entre les deux Eglises — puisque l’Eglise est Une et Universelle — mais entre les deux mondes, les deux humanités pour ainsi dire qui ont suivi ces deux drapeaux différents.
Elle n’explique pas suffisamment comment ce qui a dévié alors, a dû de toute nécessité aboutir au terme où nous le voyons arriver aujourd’hui.
Jésus-Christ avait dit: «Mon Royaume n’est pas de ce monde»; — eh bien, il s’agit de comprendre comment Rome, après s’être séparée de l’Unité, s’est crue en droit, dans un intérêt qu’elle a identifié avec l’intérêt même du christianisme, d’organiser un Royaume du Christ comme un royaume du monde.
Il est très difficile, nous le savons bien, dans les idées de l’Occident de donner à cette parole sa signification légitime; on sera toujours tenter de l’expliquer, non pas dans le sens orthodoxe, mais dans un sens protestant. Or, il y a entre ces deux sens la distance, qui sépare ce qui est divin de ce qui est humain. Mais pour être séparée par cette incommensurable distance, la doctrine orthodoxe, il faut le reconnaître, n’est guère plus rapprochée de celle de Rome — et voici pourquoi:
Rome, il est vrai, n’a pas fait comme le Protestantisme, elle n’a point supprimé le centre chrétien qui est l’Eglise, au profit du moi humain — mais elle l’a absorbé dans le moi romain. — Elle n’a point nié la tradition, elle s’est contentée de la confisquer à son profit. Mais usurper sur ce qui est divin n’est-ce pas aussi le nier?.. Et voilà ce qui établit cette redoutable, mais incontestable solidarité qui rattache à travers les temps l’origine du Protestantisme aux usurpations de Rome. Car l’usurpation a cela de particulier que non-seulement elle suscite la révolte, mais crée encore à son profit une apparence de droit.
Aussi l’école révolutionnaire moderne ne s’y est-elle pas trompée. La révolution, qui n’est que l’apothéose de ce même moi humain arrivé à son entier et plein épanouissement, n’a pas manqué de reconnaître pour siens et de saluer comme ses deux glorieux maîtres Luther aussi bien que Grégoire VII. La voix du sang lui a parlé et elle a adopté l’un en dépit de ses croyances chrétiennes comme elle a presque canonisé l’autre, tout pape qu’il était.
Mais si le rapport évident qui lie les trois termes de cette série est le fond même de la vie historique de l’Occident, il est tout aussi incontestable qu’on ne saurait lui assigner d’autre point de départ que cette altération profonde que Rome a fait subir au principe chrétien par l’organisation qu’elle lui a imposée.
Pendant des siècles l’Eglise d’Occident, sous les auspices de Rome, avait presque entièrement perdu le caractère que la loi de son origine lui assignait. Elle avait cessé d’être au milieu de la grande société humaine une société de fidèles librement réunie en esprit et en vérité sous la loi du Christ. Elle était devenue une institution, une puissance politique — un Etat dans l’Etat. A vrai dire, pendant la durée du moyen-âge, l’Eglise en Occident n’était autre chose qu’une colonie romaine établie dans un pays conquis.
C’est cette organisation qui, en rattachant l’Eglise à la glèbe des intérêts terrestres, lui avait fait, pour ainsi dire, des destinées mortelles. En incarnant l’élément divin dans un corps infirme et périssable, elle lui a fait contracter toutes les infirmités comme tous les appétits de la chair. De cette organisation est sortie pour l’Eglise romaine, par une fatalité providentielle, — la nécessité de la guerre, de la guerre matérielle, nécessité qui, pour une institution comme l’Eglise, équivalait à une condamnation absolue. De cette organisation sont nés ce conflit de prétentions et cette rivalité d’intérêts qui devaient forcément aboutir à une lutte acharnée entre le Sacerdoce et l’Empire — à ce duel vraiment impie et sacrilège qui en se prolongeant à travers tout le moyen-âge a blessé à mort en Occident le principe même de l’autorité.
De là tant d’excès, de violences, d’énormités accumulés pendant des siècles pour étayer ce pouvoir matériel dont Rome ne croyait pas pouvoir se passer pour sauvegarder l’Unité de l’Eglise et qui néanmoins ont fini, comme ils devaient finir, par briser en éclats cette Unité prétendue. Car, on ne saurait le nier, l’explosion de la Réforme au seizième siècle n’a été dans son origine que la réaction du sentiment chrétien trop longtemps froissé, contre l’autorité d’une Eglise qui sous beaucoup de rapports ne l’était plus que de nom. — Mais comme depuis des siècles Rome s’était soigneusement interposée entre l’Eglise universelle et l’Occident, les chefs de la Réforme, au lieu de porter leurs griefs au tribunal de l’autorité légitime et compétente, aimèrent mieux en appeler au jugement de la conscience individuelle — c’est-à-dire qu’ils se firent juges dans leur propre cause.
Voilà l’écueil sur lequel la réforme du seizième siècle est venue échouer. Telle est, n’en déplaise à la sagesse des docteurs de l’Occident, la véritable et la seule cause qui a fait dévier ce mouvement de la réforme — chrétien à son origine, jusqu’à la faire aboutir à la négation de l’autorité de l’Eglise et, par suite, du principe même de toute autorité. Et c’est par cette brèche, que le